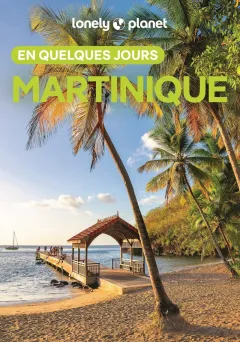La Martinique présente mille visages : outre le farniente sur ces plages paradisiaques, « l'île aux fleurs » offre un large panel d'activités sportives : voile, kayak, surf, plongée, randonnée, canyoning… Une belle façon de découvrir la faune et la flore locales ! Les gourmands découvriront avec délice une gastronomie métissée et un rhum réputé… qui coule à flots lors des fêtes de l'île, comme le célèbre carnaval ! Découvrez les lieux et choses incontournables à voir et à faire en Martinique.
Le catalogue des éditions Lonely Planet
L’évasion commence ici, découvrez nos guides et livres de voyage.
La Martinique, surnommée "l'île aux fleurs", est une destination paradisiaque où se mêlent plages de sable blanc, eaux cristallines, montagnes verdoyantes et une culture vibrante. Située dans les Caraïbes, cette île française allie richesse naturelle et historique, offrant aux visiteurs une expérience inoubliable. Que vous soyez amateur de nature, de culture ou de détente, voici un guide des incontournables à ne pas manquer lors de votre séjour en Martinique.
1. Explorer le parc naturel régional de la Martinique
Le cœur vert de l'île, le parc naturel région de la Martinique, s'étend sur près de 65 % du territoire. Ce parc offre une diversité de paysages à couper le souffle, des forêts tropicales luxuriantes aux montagnes volcaniques. Il abrite des sentiers de randonnée pour tous les niveaux, comme la montagne Pelé, un volcan actif, qui offre une vue spectaculaire après un effort soutenu.
Les amoureux de nature pourront également découvrir la Savane des Pétrifications, un lieu unique où la végétation désertique contraste avec la verdure de l'île. Ne manquez pas les gorges de la Falaise, un site impressionnant où l'eau dévale les rochers dans une cascade.
2. Détente et baignade sur les plages de rêve
La Martinique regorge de plages paradisiaques. Parmi les plus célèbres, la plage des Salines, au sud de l'île, se distingue par son sable blanc et ses eaux turquoise. C’est un lieu idéal pour se détendre, faire de la plongée avec tuba ou tout simplement savourer un déjeuner créole les pieds dans l'eau.
La plage de Grande Anse d'Arlet, plus calme et pittoresque, est parfaite pour observer les tortues marines en snorkeling. Les plages de Tartane et de la Pointe du Bout, plus animées, offrent également une belle expérience de baignade, avec des bars et restaurants typiques en bord de mer.
3. Plonger dans l'histoire à Fort-de-France
La capitale de la Martinique, Fort-de-France, est le centre névralgique de l'île, alliant modernité et histoire. La ville regorge de sites historiques, comme le Fort Saint-Louis, un imposant fort militaire construit au XVIIe siècle, offrant une vue imprenable sur la baie.
Le marché couvert de Fort-de-France est l'endroit idéal pour découvrir les saveurs locales, avec des épices, des fruits tropicaux, des artisanats créoles, et même du rhum martiniquais. Pour une immersion dans l’histoire coloniale de l'île, rendez-vous au musée de la Pagerie, la maison natale de l’impératrice Joséphine, première épouse de Napoléon Bonaparte.
4. Découvrir le Jardin de Balata
À quelques kilomètres de Fort-de-France, le Jardin de Balata est un véritable havre de paix. Ce jardin botanique est une véritable oasis de verdure, avec plus de 3000 espèces de plantes tropicales, des arbres majestueux et des fleurs exotiques. Promenez-vous sur ses ponts suspendus et laissez-vous envoûter par la beauté de cet écrin de nature.
5. Parcourir la Route de la Trace
La Route de la Trace traverse le centre de l’île et relie Fort-de-France à la commune de Le Morne-Rouge, en passant par de magnifiques paysages montagneux. En chemin, vous découvrirez des points de vue imprenables, des villages créoles typiques et des cascades cachées comme la cascade de la Désirade. Cette route, au cœur de la forêt tropicale, est idéale pour une excursion en voiture ou à moto.
6. Visiter la distillerie Saint-James
La Martinique est l'une des plus grandes régions productrices de rhum au monde. Une visite à la distillerie Saint-James est une immersion dans le processus de fabrication du rhum, de la canne à sucre à la distillation. Profitez de la visite pour déguster des rhums agricoles, réputés pour leur qualité, dans un cadre magnifique, au bord de la mer.
7. Randonner dans le sud au Domaine d’Emeraude
Le Domaine d’Emeraude, un vaste parc de 100 hectares, est un lieu privilégié pour la randonnée. Situé dans le sud de l'île, il offre un dépaysement total avec ses sentiers bordés de fougères géantes et ses panoramas époustouflants sur la mer des Caraïbes. C’est un lieu parfait pour les amoureux de la nature et ceux en quête de calme.
8. Savourez la cuisine locale
La cuisine martiniquaise est un véritable voyage gustatif. Entre influences créoles, africaines, indiennes et européennes, elle ravira vos papilles. Ne manquez pas de goûter aux spécialités comme le colombo de poulet, un curry typiquement antillais, ou le boudin créole, ainsi que les délicieuses accras de morue. Accompagnez ces plats d’un verre de ti-punch, la boisson emblématique de l’île, à base de rhum, de sucre de canne et de citron vert.
9. Faire une croisière autour de l’île
Une des meilleures façons d’admirer la beauté de la Martinique est de la découvrir en bateau. Plusieurs compagnies proposent des croisières qui vous emmènent autour de l'île ou jusqu'à des îles voisines comme Les Anses d’Arlet ou l'île aux Pétrons. Ces excursions vous permettront d’explorer des plages isolées, des spots de plongée exceptionnels et des paysages marins à couper le souffle.
10. Participer à un festival local
La Martinique est une île animée, pleine de festivals et d’événements tout au long de l’année. Parmi les plus célèbres, le carnaval de Martinique est un événement incontournable qui se déroule en février et mars, avec des défilés colorés, de la musique et des danses traditionnelles. L'été martiniquais, célébré de juin à août, est également un moment idéal pour découvrir la culture locale à travers des concerts, des spectacles de danse et des manifestations gastronomiques.