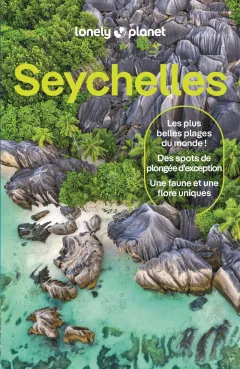-
Publié le 10/04/2020 7 minutes de lecture
Début mars, le spectre de l’épidémie de Coronavirus se rapproche dangereusement de la France, même si personne n’a encore idée de l’ampleur qu’elle va prendre. Notre auteure Elodie Rothan part alors en mission pour Lonely Planet, vers un lieu considéré comme un paradis sur terre: les Seychelles ! Elle nous raconte son début de séjour, les démarches à faire sur place avec sa famille qui l'avait rejointe et son périple pour réussir à rentrer en France.À l'atterrissage, le soleil brille, il fait 30 degrés, les gens sont souriants, détendus. Le Corona ? "On a eu une grosse fièvre en novembre, mais c'est passé. On fait attention. De toute façon, avec cette chaleur, le virus ne passera pas !". A Beau Vallon, l’un des lieux les plus touristiques de l’île, je bois une bière en bord de plage, face au coucher du soleil. Le bar est bondé, la musique reggae, les gens rient. Que le virus semble loin ! Aux Seychelles, aucun cas n’est encore répertorié.Quelques jours plus tard, dans une île-hôtel paradisiaque, devant mon écran de télévision, j’assiste, éberluée, aux premières annonces du président de la République française. Le stress s’immisce petit à petit dans mon quotidien. Je croise quelques Seychellois angoissés: "Et si ça arrivait ici ? Nous ne pourrons pas faire face, nous sommes un petit pays, notre système de santé est fragile. Il n'y a que 10 places à l'hôpital, c'est tout." J'acquiesce. Je ne peux qu'espérer.

Il était prévu que Louis, mon conjoint, me rejoigne. Mais le doit-il? Après de longues hésitations, il prend le risque de venir avec les enfants. J’approuve, consciente qu’une course contre la montre s’est engagée. Lorsqu’un matin, à l’aéroport, je les sers dans mes bras, le moment est magique. Le monde peut s’écrouler, ils sont là.Nous partons alors à La Digue, une petite île au large, où il n’y a pas de voiture: tout se fait à vélo. Notre maison, toute en bois, est ouverte sur l’océan. On se détend. Enfin non. On essaie. Les téléphones deviennent un anxiogène permanent. L'écran m'hypnotise. Les nouvelles sont ahurissantes. Le confinement total est décrété en France, les bourses s’effondrent, le nombre de cas explose. Le décalage entre ma vue sur mer et ce que je lis est vertigineux.Je visite les alentours. Mes yeux sont en déconnexion complète avec mon sentiment de panique intérieure. Des rochers sculpturaux bordés de sable blanc plongent dans une mer couleur turquoise. La beauté est saisissante. Comment un tel écart est-il envisageable ? Les heures passées devant les informations me replongent dans une réalité qui gagne du terrain. Mes enfants sont là. Ils ont faim, ils ont chaud. Ils me rappellent à la seule réalité qui soit : celle du ici et maintenant.

La panique monte d'un cran lorsque je lis des articles mentionnant des cas graves chez de jeunes enfants. Peut-être provoqués par la prise d'anti-inflammatoires, mais rien n'est sûr. Je comprends que ce virus est une loterie. Personne ne sait avec certitude où il va frapper. La sueur froide monte dans mon dos. Je mesure combien est loin désormais ma maison. Aux Seychelles, le nombre de cas est passé à 7, pour 95000 habitants. La situation peut basculer d’un jour à l’autre. À La Digue, depuis peu, il y a une petite pharmacie. Quelques moments de bonheur sont volés. Un rire de mon fils courant sur la plage. La fierté de ma fille qui arrive enfin à pédaler - et apprendre à faire du vélo à La Digue, ce n'est quand même pas donné à tout le monde !

Nos vols respectifs de retour sont annulés. L’Europe ferme ses frontières. Les Seychelles interdisent leur accès aux Européens. Une confusion presque totale et très étrange s’installe, dans laquelle nous devons prendre, de façon concomitante, un ensemble de décisions sur des niveaux d’urgence totalement disproportionnés: suivre l’évolution de l’épidémie, trouver à manger, s’informer des annulations – en cascade – de vols, contacter les compagnies aériennes, chercher un logement, vérifier les législations des États, boire. A force d'avoir la tête plongée dans un évènement international apocalyptique, on en arrive à ne plus avoir d'eau potable. Parce qu'à 30 degrés sous l'équateur, à quatre, il faut transporter plusieurs litres d'eau par jour, sur une île où tout se fait à vélo.Et on en oublie l’essentiel. Coline, ma fille, blonde aux yeux bleus, la peau pâle avec des tâches de rousseur, attrape des coups de soleil. Et de la fièvre. 39,4°. «C'est une insolation», me dit Louis. Bien sûr. C'est évident. Cela ne peut pas être autre chose. C'est une insolation. Point. Doliprane. Lit. Tout va bien. 38,5° au matin.Le lendemain, ma fille se porte comme une fleur. Elle ne sent plus sa fièvre, elle veut se baigner. Je l'emmène déjeuner au bord de la plage, à pied, à l'ombre. On croise d'énormes tortues terrestres. Coline les caresse. Est-ce que le virus peut se trouver sur le dos de ces tortues ? Je commence à envisager les choses bizarrement. Ce n'était peut-être rien. C'était peut-être un cas de porteur sain. Je ne peux pas savoir. Je tente un foulard improvisé en guise de masque, mais faire tenir un truc pas conforme à un enfant de 7 ans débordant d'énergie sous une chaleur tropicale est quelque chose d'assez difficile à réaliser. Sans parler de mon fils, Edgar, 3 ans, toujours sage et obéissant, cela va de soi. Alors on fait avec. On fait au mieux.

De toute façon, on n’a pas le temps de tergiverser. Notre second vol est, à son tour, annulé. Les connexions wifi sont aléatoires, chaque appel coûte une fortune, chaque information est bouleversée, les hôtels ferment les uns après les autres et les sites des compagnies aériennes ne sont plus fiables. Lorsque l’on commence à chercher un hébergement, on croise quelqu’un qui a peut-être une idée sur un vol via La Réunion, ou via Abu Dhabi, ou via Francfort, ou… alors on arrête tout, on cherche une connexion, on passe des heures d’attente au téléphone pour ne pas louper peut-être la seule chance de rentrer en France.Dans notre l’hôtel, une Allemande, je crois, fait un malaise. Elle n’arrive plus à respirer. Le gardien appelle les urgences. On apprendra que ce n’était qu’un mal de ventre, une légère nausée, peut-être un verre d’alcool de trop. Au matin, une des réceptionnistes porte un masque. Elle ne se sent pas bien, nous dit-elle. Le lendemain, elle l’aura ôté. Se sent-elle mieux? On ne sait pas où il est. On ne connait sa forme effrayante qu’à travers les informations. C’est celle que côtoie quotidiennement le personnel hospitalier, nos guerriers – toute ma considération envers eux.Mais l’autre forme, celle qui sans doute rampe beaucoup plus vite, comment la mesurer, l’envisager? Quand on est chez soi, on peut prendre toutes les mesures nécessaires. Quand on est dans un pays étranger, que l’on doit se déplacer, se nourrir, etc., ce n’est pas possible. Tous les gens avec qui j’échange en France me demandent si nous prenons bien nos précautions. Je leur réponds que oui. Tenir à distance l’angoisse est nécessaire, vital même. J’ai allumé mon téléphone et, dans la sélection d‘articles, il y avait un titre du genre «Les hôpitaux s’apprêtent à accueillir de jeunes enfants». Je n’ai pas cliqué. Je n’ai pas lu.

Nous finissons par trouver une maison à Mahé, grâce à mes recherches préliminaires pour le guide (et ce sera l’un des bons plans de notre prochaine édition!). Elle est ravissante. C’est une vieille maison créole avec des portes en bois, des volets bleus, un parquet qui grince et la mer à l’horizon. Nous découvrons en douceur le confinement, dans des conditions privilégiées. La plage déserte est juste en bas, il y a une épicerie à 50 mètres et des pêcheurs qui vendent leurs poissons du jour. Cela peut tenir. En quelques jours, presque plus aucun avion ne vole dans le ciel, la circulation automobile a drastiquement chutée, nombre d’entreprises sont fermées, 1,2 milliards d’habitants sont confinés chez eux, les pays se cloisonnent. Le monde a été bouleversé.Ma mère me dit que les nouvelles que je lui envoie sonnent comme les derniers échos d’une vie normale. Est-ce que je témoigne de quelque chose qui est en train de disparaître? Les quelques personnes avec qui nous avons parlé au téléphone semblent en apnée. Comme une soudaine bouffée d’oxygène, leur débit de paroles, pourtant enjouées, dénote une pression inhabituelle. Les enfants dorment. Il pleut. Des goyaves tombent sur le toit de la maison. J’entends le ressac des vagues. J’ai quitté une France normale. Quel monde vais-je retrouver? Nous devons nous préparer au retour.Nous sommes finalement enregistrés sur le vol de rapatriement des Allemands, pour Francfort. Long et coûteux, notre retour prendra trois jours. Nous prévoyons une nuit à Francfort et une escale à Amsterdam. Chaque étape, chaque maillon, chaque détail n’est plus comme avant. Les distances ont repris leur plein pouvoir.Les aéroports sont déserts. Nous traversons un monde étrange. C’est le même, mais il a insidieusement changé. Je nettoie aux lingettes désinfectantes les chaises hautes où jouent mes enfants, et je crois bien que les gens ne me prennent même pas pour une folle. Une fois à Paris, cela devrait aller se disait-on. Mais pas du tout. C’est même là que cela se corse.Les déplacements en France sont devenus quasi-impossibles. Les liaisons aériennes vers Marseille sont à l’arrêt, plus aucun train n’est réservable. Je commence à envisager l’ampleur de la situation. Il faut du temps pour changer ses reflexes, ses paradigmes. Dans la longue file d’attente de la douane française, nous entendons des énervements, des cris d’incompréhension. Des Provinciaux n’ayant pas de billets justifiant leur trajet vers la province ne peuvent pas passer la frontière. Après ces jours de voyage, d’errance, de kilomètres traversés, c’est aux portes de notre propre pays que nous sentons l’angoisse monter. Heureusement, nous avions opté pour une location de voiture. Grâce au justificatif, nous sommes admis sur le territoire français. Je ne sais ce qui serait advenu sans cela. Nous aurions erré dans les couloirs éclairés au néon de la zone de transit de l’aéroport CDG.Je conduits à travers un pays fantôme. La longue piste goudronnée étale en droite ligne son ruban noir, méticuleusement strié de blanc. De part et d’autre se déploient champs, collines et forêts. Au-dessus surplombe un immense ciel nuageux, ouvert sur l’infini. L’autoroute est déserte. Je compte sur les doigts d’une main les voitures croisées depuis des centaines de kilomètres. Dans la lumière de fin de journée, des grappes d’oiseaux noirs s’attardent autour des bandes asphaltées, étrangement calmes pour eux. Ils s’envolent à mon passage.A 2h du matin, je pousse notre petit portillon en fer, celui qu’il faut ouvrir d’un coup sec et qui grince un peu. J’entends mes propres pas sur le parterre de galets. Ce ne sont pas exactement des graviers, qui donnent un bruit crissant: ce sont de petits cailloux ronds, polis, déclinant toute une palette de beige et de gris. Ils crissent aussi, mais je soupçonne leur son d’être plus musical. Et dans cette nuit pas si sombre, j’aperçois la silhouette de notre grand poirier. Il s’étale de part et d’autre du ciel étoilé. Au matin, chaque meuble, chaque objet a repris sa place exacte et tous ensemble forment cette composition familière et rassurante dont l’image m’apparait aujourd’hui merveilleuse: celle de mon foyer. Cela fait presqu’un mois que je suis partie. Ce n’est pas si long. Peut-être aimè-je autant voyager pour ces moments là. Partir pour mieux se retrouver.
Retrouvez l'univers d'Elodie Rothan et tous ses voyages sur son site