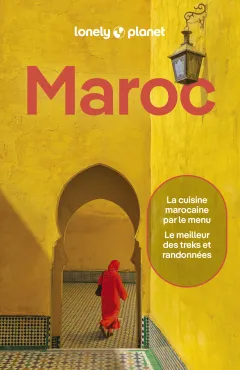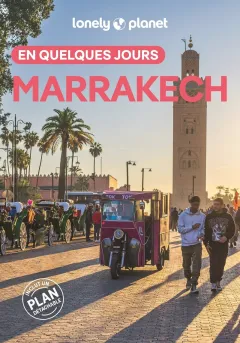Pour comprendre Marrakech, il faut se frotter à sa foule, arpenter ses ruelles, pousser la porte de ses palais, goûter à sa cuisine...car la "ville rouge" du Maroc fait appel à tous les sens.
Le catalogue des éditions Lonely Planet
L’évasion commence ici, découvrez nos guides et livres de voyage.
Marrakech, surnommée la Perle du Sud, est une ville envoûtante et pleine de charme, où l'histoire se mêle à la modernité, et où les saveurs orientales enflamment les sens. Si vous prévoyez de visiter cette destination magique, laissez-vous guider à travers ses trésors incontournables. Voici une sélection des plus belles choses à faire à Marrakech pour une expérience inoubliable.
1. Se perdre dans les méandres de la médina
La Médina de Marrakech est un labyrinthe fascinant où chaque rue révèle une nouvelle surprise. Promenez-vous dans ses étroites ruelles, imprégnez-vous de ses parfums enivrants, admirez ses somptueuses architectures traditionnelles et laissez-vous émerveiller par l'artisanat local exposé dans les souks. Une expérience sensorielle à ne pas manquer.
2. Contempler le spectacle de la place Jemaa el-Fna
La place Jemaa el-Fna est le cœur battant de Marrakech, un véritable spectacle à ciel ouvert où se mêlent musiciens, charmeurs de serpents, conteurs, et marchands ambulants. Installez-vous à l'une des terrasses surplombant la place pour observer le tumulte de la vie quotidienne, surtout à la tombée du jour lorsque les stands de nourriture offrent un festival de saveurs.
3. S'émerveiller devant les jardins de "la ville rouge"
Marrakech regorge de jardins luxuriants qui offrent des havres de paix au cœur de l'agitation urbaine. Ne manquez pas les célèbres Jardins de Majorelle, créés par le peintre français Jacques Majorelle, où le bleu électrique des bâtiments contraste magnifiquement avec la végétation luxuriante. Les Jardins de l'Agdal et de la Menara sont également des lieux de promenade incontournables.
4. Se laisser envoûter par la magie des palais
Marrakech abrite de somptueux palais témoignant de son riche passé historique. Le Palais Bahia, avec ses jardins luxuriants et ses salles richement décorées, offre une plongée dans l'opulence orientale. Le Palais El Badi, quant à lui, impressionne par ses vastes ruines qui évoquent la grandeur passée des sultans saadiens.
5. Dormir dans un riad traditionnel
Terminez votre séjour en beauté en passant une nuit dans un riad traditionnel. Ces demeures marocaines typiques, nichées au cœur de la médina, offrent un cadre enchanteur pour une expérience authentique. Imprégnez-vous de l'atmosphère feutrée et intimiste, dégustez un délicieux repas aux chandelles et laissez-vous transporter par les chants et les danses traditionnelles pour une soirée mémorable.
6. Flâner dans les souks et dénicher des trésors
Les souks de Marrakech sont un véritable paradis pour les amateurs de shopping et de découvertes. Entre les étals colorés débordant d'épices, de tissus, de céramiques et d'objets artisanaux, laissez-vous emporter par la fièvre des marchands et dénichez des souvenirs uniques à ramener chez vous. N'oubliez pas de marchander avec le sourire !
7. S'imprégner de l'art et de la culture au musée de Marrakech
Pour une immersion culturelle enrichissante, rendez-vous au Musée de Marrakech, abrité dans un magnifique palais du XIXe siècle. Vous y découvrirez une collection d'art marocain traditionnel, comprenant des textiles, des bijoux, des armes, et des objets artisanaux d'une grande finesse. Ne manquez pas de flâner dans les salles ornées de zelliges et de stucs travaillés, témoins de l'artisanat local.
8. Se relaxer dans un hammam traditionnel
Offrez-vous une parenthèse bien-être dans l'un des nombreux hammams traditionnels de Marrakech. Ces bains publics, imprégnés de traditions ancestrales, vous promettent une expérience de détente authentique. Laissez-vous dorloter par un gommage au savon noir suivi d'un enveloppement au rhassoul, et terminez par un massage relaxant aux huiles essentielles. Une véritable renaissance pour le corps et l'esprit.
9. Goûter à sa savoureuse gastronomie
La gastronomie marocaine est réputée pour sa richesse de saveurs et d'épices. Pour une expérience culinaire authentique, participez à un atelier de cuisine et apprenez à préparer le célèbre tajine, ce plat emblématique cuit lentement dans un pot en terre cuite. Vous découvrirez les secrets des mélanges d'épices et des recettes traditionnelles, et vous pourrez déguster vos créations par la suite.
10. Assister à un spectacle de Fantasia
Pour une immersion totale dans la culture marocaine, ne manquez pas d'assister à un spectacle de fantasia. Cette tradition équestre spectaculaire met en scène des cavaliers revêtus de costumes traditionnels, maniant l'art ancestral du tir à la carabine. Laissez-vous emporter par la magie de ces démonstrations équestres enflammées, accompagnées de musique et de danses folkloriques.
11. S'évader dans les environs de Marrakech
Profitez de votre séjour pour découvrir les environs de Marrakech. Partez en excursion dans la vallée de l'Ourika, où des paysages spectaculaires de montagnes et de cascades vous attendent à seulement quelques kilomètres de la cité rouge. Vous pouvez également explorer les somptueuses palmeraies environnantes à dos de dromadaire ou en quad pour une aventure inoubliable.