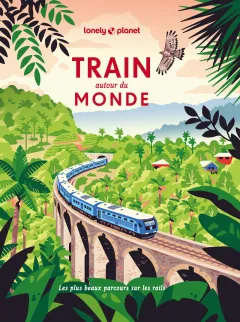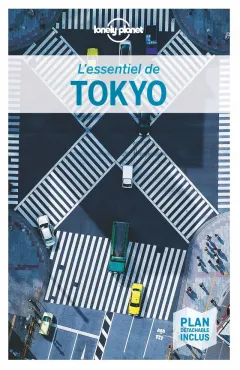-
Publié le 30/01/2020 4 minutes de lecture
Île de l'archipel nippon la plus proche de la Chine, de la Corée et de l'Asie du sud-est, la cosmopolite Kyūshū ne se limite pas à la ville martyr de Nagasaki. La preuve en 5 étapes.
Au pays de la perle de rosée
Kyūshū est réputée pour son shōchū, une eau de vie plus forte que le saké, mais aussi pour son thé. L'île produit en effet à Yame un gyokuro –une variété de thé vert dont le nom signifie “perle de rosée”–particulièrement apprécié pour sa délicatesse, primé à plusieurs reprises comme le meilleur thé du Japon. Les plantations du Yame Central Tea Garden étendent leur tapis de douces ondulations végétales au sud de la ville de Fukuoka, la plus grande localité de l'île. Depuis un observatoire situé au sommet d'une colline, 70hectares de théiers s'étendent à perte de vue, comme un océan vert tendre et miroitant. La vision est d'autant plus étonnante que les champs sont surmontés de pylônes portant des ventilateurs destinés à fournir aux plantes les conditions optimales au développement de leur saveur aromatique. Le lieu, paisible et encore peu fréquenté, est particulièrement intéressant en période de récolte, celle-ci étant effectuée majoritairement à la main. Un must pour les amateurs de thé vert!

Bien plus que des sushis
La ville de Fukuoka abrite un véritable temple culinaire nippon : Gyoten. Ce restaurant spécialisé dans les sushis est récompensé par troisétoiles au guide Michelin depuis 2014. À sa tête (en cuisine comme à la gestion), Kenji Gyoten, petit-fils de restaurateurs, a été initié à l'art exigeant des sushis dès son plus jeune âge. Cuisson parfaite du riz, découpe idéale du poisson, gestuelle millimétrée de la préparation… tout est élevé au meilleur niveau à la table de ce maître trentenaire. En cuisine comme en salle: le restaurant, malgré son aspect épuré, recèle en effet certaines pièces de vaisselle dignes de figurer dans des musées… L'addition est certes à la hauteur des lieux, mais il ne fait aucun doute que vous ne dégusterez jamais plus des sushis de la même façon après vous être attablés à Gyoten.

L'art délicat de la céramique
Île la plus au sud du pays, et donc la plus proche de la Chine, de la péninsule coréenne et des pays du Sud-Est asiatique, Kyūshū a été de longue date l'une des régions du pays les plus ouvertes au reste de l'Asie. L'art de la céramique en atteste avec une grande délicatesse. À Arita, le musée de la Céramique revient salle après salle sur l'évolution du savoir-faire des céramistes, des premières techniques venues de Corée –le pays de référence en la matière durant des siècles– à leur adaptation au style local et aux goûts européens par des maîtres japonais, de plus en plus près, au fil du temps, de dépasser le savoir-faire chinois. La présentation, chronologique, culmine avec les plus de 10000 pièces de la collection Shibata, qui datent pour la plupart de l'époque d'Edo (1603-1868). Le musée est gratuit et des visites en anglais peuvent être réservées à l'avance. Arita se situe dans la préfecture de Saga, entre les préfectures de Fukuoka et de Nagasaki.

Un village de porcelaine
Au creux des montagnes surplombant Imari, non loin d'Arita, le village d'Okawachimaya tient une place à part dans l'histoire de la céramique sur l'île de Kyūshū. En 1616, des potiers coréens découvrirent en effet à proximité un gisement de kaolin, variété d'argile blanche nécessaire à la réalisation de la porcelaine. Cette technique on ne peut plus délicate, car elle nécessite une cuisson à près de 1400°c, permet de réaliser des pièces d'une blancheur et d'une finesse inégalées. La “porcelaine d'Imari” devint ainsi mondialement connue, d'autant plus que la Compagnie Néerlandaise des Indes orientales la popularisa en y ajoutant des motifs bleus. Soucieux de préserver cette manne, les membres du clan local Nabeshima bâtirent une série de fours dans le modeste village d'Okawachimaya, et firent en sorte de le protéger des regards et des convoitises. Le bourg fut ainsi surnommé "le village des fours secrets". Aujourd'hui, ce petit hameau paisible est encore entièrement dédié à la porcelaine: une trentaine d'ateliers-boutiques bordent ses ruelles pavées où il fait bon déambuler.

Les églises de Nagasaki
Nagasaki pourrait se raconter par ses églises. Dans ce pays où le catholicisme est très largement minoritaire, deux églises chrétiennes de la ville ont en effet eu un destin tristement célèbre. La première rappelle le martyr de la ville tout entière : le 9 août 1945, la deuxième bombe atomique lancée par les États-Unis sur le Japon détruisit intégralement la cathédrale de l’Immaculée-Conception (aussi appelée cathédrale d’Urakami), qui était alors la plus grande église catholique d'Asie. Rebâtie en 1959, elle présente derrière sa haute façade de briques quelques rares artefacts du bâtiment d'origine, bâti par des prêtres missionnaires français, qui rendent sa visite particulièrement émouvante. Plus proche du centre-ville, l'église d'Oura (aussi connue sous le nom d’église des Vingt-Six-Martyrs) a pour sa part été inscrite en 2018 sur la liste du patrimoine mondial de l'Unesco, en même temps que onze autres "sites chrétiens cachés de la région de Nagasaki", qui témoignent de l'interdiction de la foi chrétienne dans le pays entre les XVIIe et XIXesiècles. Préfigurant le retour en grâce des communautés chrétiennes, cet édifice de briques blanches de style néogothique a été construit en 1864 grâce aux efforts du père français Bernard Petitjean, en l'honneur de prêtres européens et japonais crucifiés dans la ville en 1597.